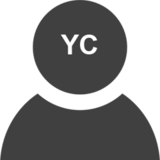Réunions
Première rencontre des Anciens élèves de la région : « Nouvelle Calédonie »
Samedi 23 Août 2014
Pour cette matinée au cœur de l’hiver austral (température de 22°C et soleil voilé), 5 anciens et 1 future diplômés de l’école, basés en Nouvelle Calédonie se sont retrouvés sur l’exploitation de vanille de Julien PASCAL, jeune œnologue reconverti !
La vanille, introduite en Nouvelle Calédonie par les pères missionnaires au XIX ème siècle est encore aujourd’hui principalement cultivée sur l’île de Lifou par les tribus comme complément de revenus.
Julien a fait le pari, il y a quelques années d’en développer la culture sur la grande Terre. Il a ainsi construit deux grandes ombrières et y a bouturé 700 plants issus de Lifou. Sa passion et ses connaissances techniques lui ont permis de développer une pratique culturale spécifique et une technique de maturation dont il peut être fier car sa vanille, après 2 ans de culture, 9 mois de soins manuels après la première floraison et 9 mois de maturation a remporté en 2012 une médaille de bronze au concours du Salon de l’Agriculture de Paris.
Alors que la teneur moyenne en vanilline des gousses de vanille sur le marché mondial est de l’ordre de 2%, Julien produit aujourd’hui une vanille avec une teneur supérieure à 4%, ce qui lui a valu en 2013, une médaille d’argent au concours agricole et en fait un produit très demandé par le secteur de l’agro-alimentaire et le monde de la parfumerie.
Après une visite des ombrières durant laquelle Julien nous a fait partager son enthousiasme, il nous a fait découvrir son nouveau projet : la culture en milieu naturel. Il a, en effet, début 2014, planté 600 boutures de vanille au cœur d’une forêt, sur le site d’une ancienne tarodière* qu’il a réaménagé , ce qui lui permet de bénéficier pour ces orchidées, d’une terre drainée, ombragée et riche en matières organiques. De plus, il utilise les anciennes allées de la tarodières pour faciliter le cheminement entre les plants. Un projet qui s’inscrit pleinement dans les démarches de développement durable.
Après cette visite passionnante, nous nous sommes retrouvés chez Elise autour d’un repas calédonien (cari de cerf, bami…) préparé par tous. Pour marquer ces retrouvailles un verre de coteaux du Layon a marqué le début d’un déjeuner très convivial.
Rendez-vous a été pris pour renouveler cette rencontre en élargissant le groupe aux anciens absents ce jour ainsi qu’aux anciens de toute la zone Pacifique (Raphael, basé en NZ n’avait en effet pas pu faire le déplacement pour cette première rencontre).
*Culture du tarot
Présentation de la Nouvelle Calédonie
La Nouvelle-Calédonie, à l’ouest du Pacifique Sud, s’étire sur 400 km de long et 50 km de large. Sa superficie est de 18 750 km2 et son sommet culmine à 1629 m.
Un peu d’histoire
Les plus anciennes traces de présence d’Homme en Nouvelle-Calédonie remontent à la période Lapita (-1 300 à -200), du nom de la poterie de l’époque avec des motifs allongés faits à l’aide d’un battoir en bois.
La découverte, par les européens, intervient le 4 septembre 1774. James Cook débarque dans la baie de Balade et baptise l’île « New-Caledonia » en souvenir de la région calédonia, dont il est originaire, et on dit que l’aspect des côtes lui aurait rappelait cette région.
Le 24 septembre 1853, sur ordre de Napoléon III, le Contre-Amiral Febrier-Despoints prend officiellement possession de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif de ces premières missions françaises est d'étudier la possibilité d'une colonisation et l'installation d'un bagne.
Le Bagne marque très profondément l’histoire de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Les racines familiales de bon nombre de calédoniens puisent leur source dans la déportation.
En 1864, une loi donne la possibilité aux condamnés "rendus dignes d’indulgence" d’obtenir une concession de terrain. Les principaux domaines sont octroyés à Bourail, La Foa, le Diahot, Pouembout et Prony. 110 000 hectares des meilleures terres du pays, souvent prélevées au détriment des tribus, sont donnés aux condamnés de droit commun.
La colère se fait alors sentir chez les mélanésiens poussés hors de leurs terres par le front de colonisation. En 1878, Ataï, Grand Chef de Komalé, devient le symbole d’une révolte sanglante qui marque profondément les revendications mélanésiennes. Près de 5% de la population est tuée lors de la répression des attaques.
La seconde guerre mondiale revêt une grande importance dans l’histoire de l’île. La Nouvelle-Calédonie était en effet la principale base américaine extérieure dans le Pacifique. 600 000 militaires américains y séjournèrent et les troupes américaines comptèrent jusqu’à 50 000 hommes.
Territoire de peuplement pluri-ethnique, la Nouvelle-Calédonie accède au statut de territoire d'outre-mer en 1946. La Nouvelle-Calédonie a connu de nombreux statuts depuis 1946 et son passage de colonie à Territoire d'outre-mer (TOM).
Durant la période des troubles politiques, sociaux et communautaires de la période des « Évènements » (1984 -1988), les gouvernements successifs tentent de régler le problème des affrontements entre partisans et opposants à l'indépendance par plusieurs modifications des statuts du Territoire.
Après la signature des accords de Matignon-Oudinot , qui ramènent la paix civile en Nouvelle-Calédonie , des 26 juin et 20 août 1988 , une loi référendaire est adoptée le 9 novembre 1988 pour établir un nouveau statut transitoire pour dix ans.
La Nouvelle Calédonie d’aujourd’hui
L’île principale, nommée la « Grande Terre » est bordée d’un récif barrière de 1600 km de long englobant de nombreux îlots. A l’extérieur du lagon, des archipels bordent l’île principale : au nord les îles Belep, à l’est les îles Loyautés et au sud l’île des Pins. Baignée par un climat subtropical, la Nouvelle-Calédonie connaît deux saisons marquées, l’une, chaude et humide, de novembre à mars et l’autre plus fraîche de juin à septembre. La côte Ouest de la Grande Terre subit une période sèche drastique entre octobre et décembre.
Les caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie déterminées par sa géologie, l’ancienneté de son isolement géographique, ainsi que sa situation en zone inter-tropicale, sont à l’origine du développement d’une faune et d’une flore originales qui présentent une grande diversité et un taux d’endémisme élevé. Ces originalités positionnent la Nouvelle-Calédonie parmi les 25 « points chauds » de la biodiversité mondiale, englobant 4 des 238 écorégions identifiées à travers le monde (Programme Global 200) :
-
les forêts humides,
-
les forêts sèches,
-
le récif corallien,
-
les rivières et ruisseaux.
La population multiculturelle de N.C est estimée à 200 000 habitants, dont les 2/3 vivent dans le Grand Nouméa (province Sud). Des ethnies variées amenées par les courants de l’histoire s’y côtoient (mélanésiens, polynésiens, asiatiques, européens…).
L’économie calédonienne est dominée par trois grands secteurs : l’industrie minière et métallurgique, centrées sur la production de nickel, les administrations et les commerces.
Ces secteurs représentent ensemble 78 % du PIB, lequel s’élève en 1997 à 2,9 milliards d’euros. La monnaie locale, le franc pacifique (FCFP) a une parité fixe avec l’euro (100FCFP = 8,38 €).
La pratique de l’élevage est surtout développée sur la côte Ouest. Les productions agricoles, aquacoles et marines, ainsi que le tourisme, sont des secteurs en pleine croissance.
Pour assouvir votre curiosité sur la Nouvelle Calédonie :
-
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr
-
http://www.gouv.nc
Mais qui sont ces ingénieurs du bout du monde ?
Chloé CHIRON est actuellement en "formation ingénieur ESA" par l'intermédiaire de l'apprentissage avec un contrat de 3 ans (2013-2016) à la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire.
Chloé a précédemment suivi une licence de biologie des organismes et de l'environnement (2010-2013) à l'Université de Rennes 1 avec en dernière année, un stage à la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique sur la réduction des produits phytosanitaires par l'intermédiaire des systèmes de culture innovants. Dans le cadre de sa formation, d’ingénieur, Chloé a eu l'opportunité en 2014, de faire une "mission à l'international" à la Chambre d'agriculture de de Nouvelle Calédonie où elle travaille sur les ravageurs souterrains et les moyens de lutte contre ces espèces.
Pauline BAUDHUIN a été diplômée en 2006, après un DA Agrécina (Agroécologie et innovations agronomiques).
Après avoir travaillé à la Chambre de Loire-Atlantique, puis à l’INRA de Rennes sur les Mesures Agri-Environnementales. Elle part ensuite à Mayotte en 2008 à la Direction de l’Agriculture et de la Forêt pour travailler toujours sur les MAE, puis sur la coordination d’un projet sur la valorisation des projets agricoles locaux et enfin sur la gestion et la coordination de fonds publics pour le développement économique.
Arrivée en Nouvelle-Calédonie en 2013, en tant que directrice d’une association agricole, je suis maintenant conseillère à la Chambre d’agriculture sur la mise en place de signes de qualité sur les produits agricoles locaux.
Elise BILLIAUX-SOURICE (Mariée – 2 enfants) : promo 1987, diplômée en 1992 suite DA « Echanges internationaux et stage de fin d’étude en Thaïlande.
Après quelques années en région parisienne, au sein d’une société internationale en tant que consultant et auditeur pour des démarches de certification de produits, services et systèmes de management, Elise quitte en 1999 la métropole pour ouvrir l’agence martiniquaise d’une petite société de conseil guadeloupéenne. Elle rejoint ensuite le Groupe EUROVIA comme responsable qualité, sécurité et environnement de la filiale martiniquaise.
En Nouvelle Calédonie depuis 2006, Elise est aujourd’hui directrice associée de l’INSTITUT DE LA QUALITE, société de conseil en qualité, sécurité, hygiène et environnement leader sur le marché. Elle vient également de créer une société, franchise du Groupe AFNOR, en Nouvelle Calédonie : « AFNOR PACIFIC ». Son métier la met en contact avec tous types de structures (de la société internationale à l’entreprise individuelle) et de métier (administrations, industries, services mais aussi et avec bonheur le monde agricole)
Yannick COUETE (Marié – 2 enfants) : Promo 1988, diplômé en 1993 suite au DA « Lait-viande » et mémoire de fin d’étude réalisé avec Denis LABIAU à la SOVIBA au Lion d’Angers sur la valorisation agricole des déchets de l’abattoir, notamment les boues de la station d’épuration.
De Novembre 1993 à décembre 1995, coopération technique en Guinée Conakry avec l’AFVP. Projet de développement de l’apiculture en Haute Guinée (Kouroussa) puis Conseiller de gestion au CER France à Fontenay Le Comte, Sud Vendée (1996-2002).
Arrivé en 2002 en Nouvelle Calédonie comme Responsable de la Chambre d’agriculture de Nouvelle Calédonie en province Nord, basé à Koumac et depuis 2008, Directeur général de la Chambre d’agriculture de Nouvelle Calédonie à Nouméa.
Denis LABIAU (Marié – 3 enfants) : Promo 1988, diplômé en 1993 à la suite du DA « Lait-viande » et mémoire de fin d’étude réalisé avec Yannick COUETE à la SOVIBA au Lion d’Angers sur la valorisation agricole des déchets de l’abattoir, et la maîtrise de l’eau.
De Novembre 1993 à mars 1994 : ingénieur qualité à SOVIBA Le Lion d’Angers puis d’Avril 1994 à juillet 1995 poste de Volontaire à l’Aide Technique en Nouvelle Calédonie en tant qu’adjoint au Chef d’Agence de la Banque Calédonienne d’Investissement de Poindimié sur la côte Est.
De 1995 à 1998, Chef de Produits PAI multi sites à SOVIBA Le Lion d’Angers pus retour en Calédonie en 1999 comme Directeur de l’Agence de Développement de Yaté en Nouvelle Calédonie.
De 2001 à 2007, Directeur d’Exploitation de SODEVIA SA, atelier de découpe de viandes à Nouméa.
De 2007 à 2010, Directeur Général de FINAGRO SAS, Pôle Agroalimentaire du groupe SOFINOR et Président Directeur Général de la SICA SA, usine d’aliments pour animaux à Boulouparis, Nouvelle Calédonie.
Depuis 2010 Directeur Adjoint du Groupe SOFINOR, Nouvelle Calédonie. Denis est donc au service du développement de la Province Nord.
Laurent BERTHELOT (Marié – 3 enfants) : calédonien d’origine, Laurent a intégré la promo 1988 et a été diplômé en 1993. Après un poste de volontaire à l'aide technique (service militaire dans le civil) comme technicien agricole au sein du service de l'agriculture à Wallis et Futuna (93-95), petites îles sous protectorat français à l'est de Fiji, il a ensuite été tour à tour technicien en élevage porcin (à Wallis et Futuna) puis Directeur d'une MFR (maison familiale rurale) à Ouvéa (tristement célèbre pour les évènements de Gossanah).
Début 1997, il retourne en Calédonie comme enseignant en Eco-gestion au Lycée Agricole de Pouembout. Il passe le concours d'enseignant en éco-gestion en 1999 et enseigne jusqu’en 2006. Il occupe également des fonction de coordinateur (gestion des promotions) essentiellement en BTSA ACSE (analyse et conduite des systèmes d'exploitation) puis DARC (développement de l'agriculture des régions chaudes).
Depuis 2007 il est directeur adjoint du lycée agricole de Pouembout. Laurent exerce un métier très prenant au service des apprenants et du pays. Les formations agricoles sont une des nombreuses "boite noire" du système lycée de Pouembout mais l'agriculture garde une place de choix
dans son quotidien de directeur adjoint et dans son cœur d'homme ainsi que l'ESA (personnel, enseignants et étudiants) pour tout ce qu'elle lui a apporté et lui apporte encore de bons souvenirs, d'amitié, de compétences variées…